Règlement sur les trottoirs de la Ville de Bruxelles 3
« Titre premier. Construction des trottoirs […]
Art. 12. Trottoirs en pavés
Les pavés employés à la construction des trottoirs seront d’un échantillon parfaitement égal, avec des joints d’équerre et un parement de tête carré bien dressé et uni ; ils proviendront des meilleurs bancs des carrières produisant une pierre demi-dure, non glissante, et auront les dimensions suivantes :
largeur à la tête : 14 à 16 centimètres ;
hauteur minimum : 12 centimètres ;
face à l’assiette : 10 à 12 centimètres au moins.
Les pavés de trottoirs seront posés sur un lit de mortier de 5 centimètres d’épaisseur, étendu sur une des couches de sable qui aura primitivement 15 centimètres et qui sera réduite à 10 centimètres par le pilonnage ; le fond de l’encaissement du trottoir sera parfaitement damé avant l’épandage de la couche de sable. »
Les pavés, ce n’est que la surface visible d’une superposition de strates.
Une grande précision est requise pour que la matière soit contenue, l’épaisseur aplatie.
À Bruxelles, il n’est pas rare qu’un bloc de pavé se détache, remonte en surface et crée une fissure, une petite excroissance qui fait perdre l’équilibre.

Vera
Elle crée un pli sur le revêtement du trottoir.
Elle apparaît quand il fait encore jour.
Elle n’a pas beaucoup d’affaires, parfois un caddie, toujours son sac de couchage. Parfois, elle ajoute des strates, un matelas de mousse, une couverture en dessous, une couette au-dessus, un oreiller sur lequel on aperçoit à peine les ombres formées par la courbe de sa tête. Les chaussures rangées à côté.
Elle prend place (trouve sa place, se fait une place) dans les plis que forme la rencontre du trottoir avec la façade.
Ces plis sont des espacements.
Parfois, elle reste allongée sur le côté, la tête dans le creux de sa main, le coude plié sur le sol. Son regard ne suit pas les gens qui passent, elle les voit défiler à la hauteur de ses yeux concentrés sur l’arrière-plan de la rue.
Le flux des passages n’est pas très intense.


Les rythmes des jambes, des roues de poussettes et trottinettes, de vélos d’enfants, dessinent une courbe d’évitement.
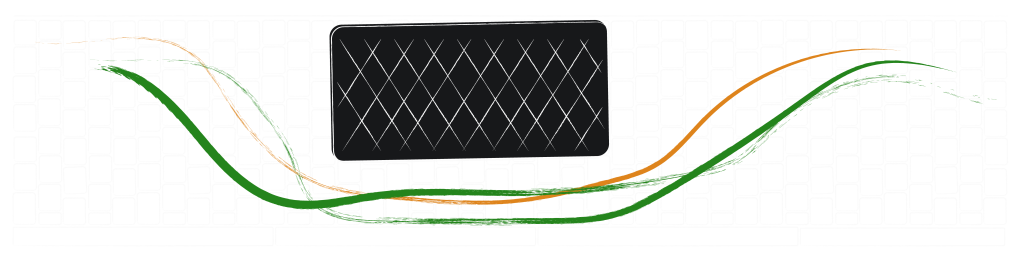
© Nuno Pinto da Cruz
Le pli est la relation entre la façade, le corps de Vera et les strates créées par la courbe des passants, leur mouvement oscillatoire.
À Bruxelles, la disposition et la taille des blocs de pavé dessinent sur le sol une grille précisément maîtrisée qui résonne sous les rues des valises.
Transporter une valise, c’est produire un son rythmé – tic tac toc tic, tic tac toc tic – qui ressemble à celui du train sur les rails et ne permet pas de passer inaperçu.
Les micro-fissures entre les blocs engendrent une résistance qui s’oppose au mouvement.
Ce n’est pas le même effort que sur un sol tout lisse, tout plat.




Élise
Élise se déplace avec deux grandes valises.
Son mouvement dans la ville est cadencé par le son du pavé ; un rythme lent, car ses valises sont lourdes.
Elle fait des pauses, fréquentes.
Quand elle s’assoit sur ses valises, son corps en prend la forme.
Les valises d’Élise, je les ai toujours pensées en tant que matérialisation de son espace personnel 1. Cet espace – immatériel – se situe immédiatement autour du corps, sorte de prolongement de l’espace intérieur, contenu par la peau.

© Nuno Pinto da Cruz
À travers l’espace personnel, chacun négocie les proximités et les distances avec les autres, ces espaces qui permettent ou empêchent les relations – physiques, émotionnelles.
Il accompagne toute personne partout où elle va, comme un territoire portable.
Ses limites sont floues et imperceptibles ; mais elles existent et peuvent être menacées, voire envahies, dans certaines circonstances. Elles se modifient en fonction des situations et des normes sociales et spatiales qui les structurent.
L’épaisseur de ces limites, tout comme leur porosité, est constamment redéfinie par les imbrications entre le corps privé et le corps public, entre l’intimité et l’exposition à l’autre.
Élise transporte, avec ses valises, son territoire portable.

© Nuno Pinto da Cruz
Un jour, elle trouve un canapé. Quelqu’un l’a laissé sur le trottoir, en bas d’un l’immeuble. « À donner », déclare la feuille attachée avec du ruban adhésif. Quatre mètres plus haut, le porte-à-faux d’un balcon. Un bâtiment moderne, une façade inspirée d’un tableau de Miro, paraît-il.
C’est un jeudi, au début de l’après-midi. Élise s’installe juste à côté du canapé ; une ligne de contact se dessine entre le tissu épais, à fleurs, et sa valise mauve grande ouverte. Son corps en prend la forme quand elle s’endort à l’intérieur. Seuls ses pieds ressortent, produisent un mouvement, une protubérance dans la démarcation de son espace personnel.
L’espace personnel n’est pas un territoire absolu. Il change et se modifie constamment, se dilate et se contracte selon les situations physiques, relationnelles, normatives, affectives.

© Elisabetta Rosa
Le territoire portable se désassemble, une partie s’arrête, le corps s’éloigne, l’espace personnel se démultiplie.

Robert Rauschenberg, « Gift for Apollo », 1959
Gift for Apollo, 1959. Oil, paint, necktie, mixed media (1925-2008) Panza Collection. MOCA, LA. Photo © rocor, 2011 (CC BY-NC 2.0). Source : flickr.com
Gift for Apollo de Robert Rauschenberg est une petite machine ambulante attachée à un seau est assemblée à partir de bric et de broc et peinte avec des gouttes et des taches.
Les œuvres de la série Combines, dont celle-ci fait partie, sont créées à partir d’éléments qui incarnent l’existence ici et maintenant et sont ainsi des objets réels, puisqu’ils renvoient immédiatement à un champ de références et d’expériences situé au-delà ou en deçà de l’œuvre d’art.
Les Combines contiennent les choses de la vie elles-mêmes, pas leur représentation. Rauschenberg souhaitait que ces œuvres soient une « reflection of life… Your self-visualisation is a reflection of your surroundings ». 2

© Elisabetta Rosa
Est-ce la valise de Élise ?
A-t-elle oublié, peut-être perdu sa valise ?

© Séverin Malaud, 2022