Une des géographies possibles de la ville « sans-abri » – pour autant que celle-ci existe réellement – se dessine, à Bruxelles, à travers des espaces où la présence de personnes qui dorment crée une sorte d’oxymore entre le caractère monumental des architectures et le caractère interstitiel de l’habiter.
Nous avons composé cette géographie en suivant des formes – celles du vestibule et des arcades – et les espaces qu’elles composent : le Pavillon des passions humaines, les Pavillons d’octroi, le Palais de justice, la Gare de la Chapelle, le Mont des arts, le Boulevard Anspach.
Entre les unes et les autres, des continuités inattendues se créent, produites par la relation entre la matière – son histoire et sa forme – et le corps des personnes sans-abri qui l’habitent, la modifient et se font ainsi une place dans la ville.
monumentalité
subst. fém.6
[En parlant d’une œuvre d’art] Caractère grandiose résultat des proportions, du style.
Monumental, -ale, -aux
A. – Relatif aux monuments […] Qui est propre aux monuments ; qui en a les particularités et notamment le caractère grandiose, imposant […]
En particulier. Qui est destiné à s’insérer dans un monument ou un ensemble décoratif […]
B. – Par analogie [En parlant d’une chose concrète] Qui est remarquable par sa taille imposante, ses proportions, son caractère grandiose […]
C. – Au sens figuré [En parlant d’une chose abstraite] Qui étonne par son caractère démesuré.
Synonyme : énorme, monstre […]
Tous ces termes parlent de quelque chose qui ne passe pas inaperçu.
Monumental·e, relève de la monstration : ce qui est fait pour être regardé. Et ce regard est étonnement. Pour que cela se produise, il faut une mise à distance, un espacement suffisant pour créer une séparation spectaculaire.
La monumentalité est la recherche d’un régime de visibilité spécifique qui se produit par contraste avec la non-visibilité de ce qui est connu, mais soustrait du regard (car trop familier), ainsi qu’à l’invisibilité de ce qui est caché (ou qui se cache).

Olafur Eliasson, « The Weather Project », 2003
Installation in Turbine Hall, Tate Modern, London. Photo © InSapphoWeTrust from Los Angeles, California, USA (CC BY-SA 2.0). Source : Wikimedia Commons
Dans l’installation de Olafur Eliasson intitulée The Weather Project (Turbine Hall, Tate Modern), un énorme soleil domine l’espace. L’émerveillement vient de sa dimension et aussi de la reproduction monumentale d’un événement atmosphérique. Une brume s’accumule et se condense en formant des nuages, qui se dissipent par la suite. Le soleil se montre, et sa lueur rend les limites physiques de l’espace architectural à peine perceptibles.
« Monumental » ne fait pas nécessairement référence aux monuments.
Les mots que j’associe aux monuments : mémoire, histoire, événement, conservation, restauration, ancrage. Tout parle d’une solidité qui serait (presque) impossible à effacer, car l’effacement impliquerait la disparition de ce que le monument célèbre et incarne – une partie de l’identité collective ?
Ce soleil qui se montre derrière la brume n’est pas commémoration de quelque chose qui n’existe plus. Il constitue, plutôt, une transfiguration du quotidien.
Le visiteur en fait l’expérience dans un espace intérieur.
L’événement rapproche le monument de la monumentalité.
Ici, ce qui importe est l’ensemble de sensations qui « ne doivent qu’à elles-mêmes leur propre conservation, et donnent à l’événement le composé qui le célèbre ». C’est ainsi que G. Deleuze et F. Guattari parlent du monument : « il confie à l’oreille de l’avenir les sensations persistantes qui incarnent l’événement ».1
L’habiter des personnes sans-abri, je l’ai souvent pensé et cherché dans les espaces interstitiels de la ville : espaces délaissés, à moitié oubliés et peu fréquentés. Des espaces souples – dirait H. Lefebvre –, disponibles à des appropriations autres, qui n’opposeraient pas trop de résistance à des significations que quelqu’un viendrait leur donner en s’y allongeant pour dormir, la nuit. Parfois avec une tente, parfois avec des structures en carton, plus ou moins complexes.
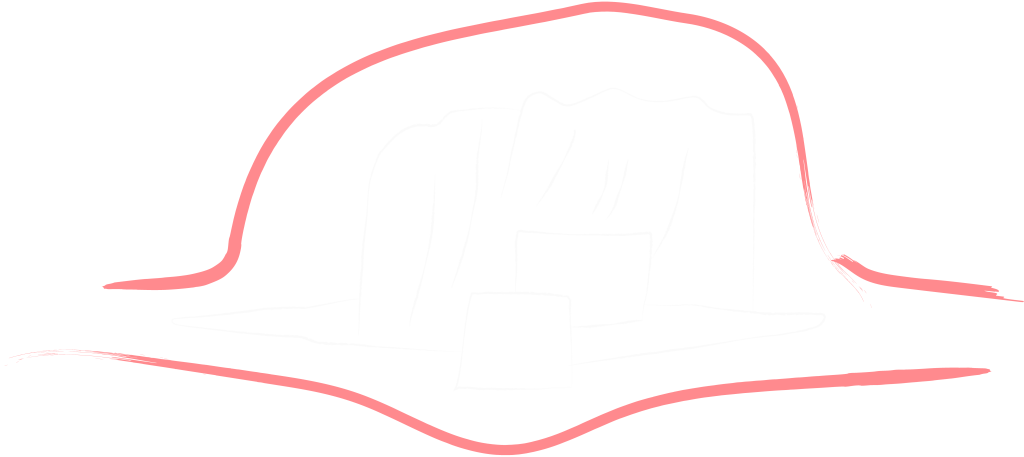
© Nuno Pinto da Cruz
Ces « architectures de survie », comme Y. Friedman les appellerait 2, ont pendant longtemps catalysé mon regard – beaucoup plus que les monuments, à vrai dire.
Et il m’a fallu du temps pour me rendre compte des relations entre monumentalités et interstices – comment les architectures de survie trouvent place là où la ville montre son caractère grandiose.
J’ai alors repensé à Deleuze et Guattari.
Que se passe-t-il quand les monumentalités rencontrent la vie – la vie vivante, celle qui coule – des personnes sans-abri ?
Il y a des micro-fissures qui adviennent – elles sont des événements, non pas des ruptures.
Ou bien, si elles sont des ruptures, elles sont « asignifiantes ».3

« Ghost Witch », Bruxelles, 2019
© Elisabetta Rosa
La pierre ne se sent pas menacée, ni la monumentalité. Elles se laissent habiter. L’étonnement n’est pas dérangé.
INTERSTICE
subst. masc.7
A. – Vieilli. Espace de temps […]
B. – Mince espace qui sépare deux choses.
Synonyme : espacement, fissure, hiatus, intervalle, jour, lézard […]
La matière et la forme architecturale conditionnent l’habitant·e et le/la dirigent vers une direction plutôt qu’une autre. « L’architecture fait monde ». 4
Encore plus, je crois, si elle est monumentalité.
Ce conditionnement n’est pas absolu. La détermination existe par différence avec l’indétermination.
La matière et la forme se laissent façonner par l’habitant·e. L’architecture est aussi « une potentialité en attente ». 5
Les interstices sont les espaces-temps des incertitudes architecturales, oscillant entre conditionnement et indétermination.
Parce qu’ils ouvrent de nouvelles possibilités, ils sont inattendus.